
Produits de la mer… Quels poissons pour demain ?
05/05/2014
Les réserves en poissons ne sont pas inépuisables. Telle est la prise de conscience de ces dernières années. Certaines des mesures prises face à la raréfaction de la ressource commencent à porter leurs fruits. Mais les avis divergent sur les solutions à adopter pour des productions durables...
Carrelets tachetés d’orange, éclat damasquiné des maquereaux, anthracite des moules, blondeur des limandes… De tous les étals du marché, celui des poissonniers est sans doute le plus attirant. Même si, depuis quelques années, ces magnifiques natures mortes ont quelque peu perdu de leur éclat avec le développement de la découpe en filets au détriment du poisson entier. Reste le plaisir de la découverte des arrivages au gré des marées. Mais pour combien de temps encore ? En 2006, une étude sur l’état de la pêche dans le monde faisait sensation en affirmant que les poissons risquaient de disparaître en 2048, si on continuait à piller au même rythme les ressources des océans. Devant le tollé suscité dans le monde scientifique par cette publication, ses auteurs durent reconsidérer leurs analyses, ce qui donna lieu à une nouvelle publication remettant largement en cause les conclusions de la précédente. Mais le ton était donné et les organisations environnementalistes ont repris à leur compte ces prévisions catastrophistes, relayées par les médias toujours en quête de sensationnel. Les reportages à charge contre la pêche professionnelle, les images chocs de tonnes de poissons écrasés dans les chaluts, d’oiseaux et de mammifères marins pris au piège, etc., font florès dans la presse, sur Internet et les réseaux sociaux.
Pourtant, bien d’autres facteurs sont responsables de la raréfaction de la ressource halieutique : réchauffement climatique, acidification des océans, hausse du niveau de la mer, pollutions liées au pétrole et autres produits chimiques… Curieusement, les lobbies environnementaux minimisent beaucoup ces nuisances. « Le pétrole a valu quelques bienfaits à la flore et à la faune marines. Les effets délétères des marées noires ont contribué à la création de quelques-uns des premiers parcs marins, de même que l’exploitation des forêts avait encouragé celle des parcs nationaux au XIXe siècle », ose même écrire Callum Roberts, professeur de conservation marine à l’université d’York et ambassadeur pour la Grande-Bretagne du Fonds mondial pour la nature, (WWF) dans son livreOcéans, la grande alarme (Flammarion). Est-ce si surprenant quand on sait que la plupart de ces ONG (Océana, WWF, Bloom association, Ocean2012, etc.) sont généreusement financées par des fondations américaines (The Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Bloomberg Philanthropies Foundation, etc.), qui bénéficient elles-mêmes de donations de puissantes compagnies gazières et pétrolières ?
Des mesures pas forcément pertinentes...
Toujours est-il que ces associations véhiculent une vision ultraconservatrice, basée sur la notion américaine du « wilderness » (nature vierge), à des années-¬lumière de la réalité géographique et économique de nos côtes européennes. Pour Guy Duhamel, professeur au Muséum d’histoire naturelle de Paris et qui a piloté la reconstitution du stock de légines dans les îles Kerguelen, « leurs campagnes se basent essentiellement sur le sentimentalisme et non sur des données scientifiques ». Sans se soucier des conséquences pour les pêcheries traditionnelles et les bassins d’emplois qu’elles représentent. En 2009, à force de lobbying, les associations environnementales ont obtenu l’interdiction de la pêche du requin-taupe dans les eaux européennes, une pêche hautement sélective et limitée à quelques centaines de tonnes par an, portant ainsi le coup de grâce aux pêcheurs de l’île d’Yeu, en pleine restructuration après l’interdiction des filets dérivants. Autre exemple d’écologie-spectacle, la campagne contre le chalutage en eau profonde menée par l’association Bloom, en décembre dernier, dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP). « Cette pêche est aujourd’hui un phénomène marginal. Elle est très surveillée, très réglementée. Certes, le chalutage profond est condamné à plus ou moins long terme, mais on ne peut pas l’interdire du jour au lendemain sans mettre en péril l’équilibre d’une filière, d’autant que les pêcheurs y sont allés avec des subventions européennes. Il faut être cohérent », remarque un chercheur qui a voulu garder l’anonymat.
Est-ce pour autant que tout va bien dans le meilleur des mondes ? Certainement pas ! Les critiques contre la surpêche sont loin d’être dénuées de fondement. En l’espace d’un siècle et demi, la course à la productivité a fait de gros dégâts. Durant des millénaires, les richesses de la mer ont semblé inépuisables. Mais, au siècle dernier, l’intensification de l’effort de pêche grâce à son industrialisation va peu à peu compromettre l’équilibre écologique des écosystèmes marins. En Europe, on encourage les pêcheurs à augmenter leurs rendements en modernisant leurs outils de production grâce à des aides financières. C’est le début d’un nouvel eldorado pour ces « travailleurs de la mer » qui voient leurs revenus, jusqu’ici très maigres, croître considérablement.
Las, au fur et à mesure des campagnes, les premiers symptômes de la surexploitation des mers commencent à se faire sentir. « C’est en 1984 que la ressource a chuté. Parce qu’avant, j’ai le souvenir de pêches miraculeuses, c’était complètement dingue !, raconte Joël Perrot, autrefois marin à bord d’un chalutier de l’Armement coopératif finistérien (ACF). Mais, tout d’un coup, le cabillaud a disparu de Nord-Écosse. On continuait à pêcher du lieu noir, de la julienne, de la lotte… On pêchait toujours du cabillaud au Sud-Irlande, mais cela n’avait rien à voir avec avant. » L’épuisement des stocks halieutiques du plateau continental, conséquence de la surpêche, pousse les professionnels à explorer les mers les plus éloignées des ports (pêche au thon dans les Maldives, légine dans les îles Kerguelen, etc.) et à pêcher toujours plus profond. Avec les conséquences dramatiques que l’on sait : destruction d’écosystèmes fragiles (coraux, éponges géantes, etc.), prélèvements massifs d’espèces éminemment vulnérables (empereur, requin siki) car leur croissance est lente et leur taux de fécondité faible, absence de sélectivité des prises, etc. Des dégâts environnementaux dont les scientifiques ont encore du mal à mesurer la portée, les profondeurs des océans demeurant très largement inexplorées. « Bien entendu, on ne peut pas pêcher sans avoir un impact sur la ressource », constate Didier Gascuel, professeur à l’Agrocampus de Rennes et membre du CSTEP (Comité scientifique, technique et économique de la pêche).
Le retour du cabillaud ?
Trouver le juste équilibre s’apparente donc à la quadrature du cercle. Les prises mondiales de poissons sauvages semblent avoir atteint leur maximum dans les années 90. Depuis, elles stagnent autour de 90 millions de tonnes annuelles, alors que la demande en produits de la mer ne cesse d’augmenter sous la pression démographique mondiale. L’Organisation des Nations unies pour l’agriculture (FAO) considère, pour sa part, que la moitié des stocks de poissons dans le monde est pleinement exploitée, et que 30 % sont surexploités. Toutefois, ces généralités dissimulent d’énormes disparités selon les zones de pêche. Dans de nombreuses régions pauvres du globe, où la pêche est une question de survie, le taux d’exploitation est trop haut pour la plupart des espèces. Alors que dans les pays développés, la tendance est à la baisse de la pression de pêche. En Europe notamment, la ressource va de mieux en mieux. Après des décennies de laxisme, les mesures mises en place par Bruxelles, les TAC (taux admissibles de captures), les POP (plans d’orientations pluriannuels), la fermeture de certaines zones de pêche et le désarmement d’une partie de la flottille européenne (assorti de subventions) commencent à porter leurs fruits. Dans le golfe de Gascogne, les captures de merlus n’ont jamais été aussi élevées. Quant au cabillaud, dont on prédisait la disparition il y a dix ans, il abonde de nouveau dans la mer de Barents, au point de déstabiliser les cours sur le marché européen. Dans la zone Atlantique Nord-Est (ANE), 25 stocks sont aujourd’hui au RMD (rendement maximal durable), contre à peine deux en 2005. Un bémol : seulement 50 % des stocks de cette zone ont été évalués. Et, en Méditerranée, la situation demeure très critique.
Deux logiques opposées...
«La réforme de la politique commune de la pêche va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin. La faiblesse de ce système est qu’il impose des obligations de moyens, mais pas d’engagement sur le résultat », assure Didier Gascuel. Pour plus d’efficacité, deux systèmes s’affrontent au sein des instances politiques européennes. Certains voudraient réduire encore le nombre de bateaux en ne conservant que les grandes unités. Un point de vue qui a déjà prévalu dans les pêcheries industrielles d’Europe du Nord. Cela passe par l’adoption d’un modèle ultralibéral, c’est-à-dire la privatisation globale des droits de pêche, avec la mise en place de quotas individuels transférables (QIT) fixant pour chaque navire la quantité maximale de poissons qu’il est autorisé à pêcher et que son propriétaire peut revendre à d’autres pêcheurs. Autrement dit, la ressource halieutique deviendrait une marchandise comme une autre, et son contrôle échapperait aux professionnels eux-mêmes, au profit de la loi du marché.
Pour d’autres, au contraire, la pêche est un outil d’aménagement du territoire qui doit prendre en compte les effets économiques induits. La gestion de la ressource passe donc par les professionnels eux-mêmes regroupés en associations. Les exemples de réussite dans ce domaine ne manquent pas, comme celui de la collecte des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, un petit gisement où 250 pêcheurs se sont mis d’accord sur les règles à respecter (période de pêche, temps de pêche dans la journée, etc.) et arrivent à vivre très correctement tout en protégeant la ressource. En Méditerranée, depuis le XVe siècle, 33 prud’homies (de Port-Vendres à Menton) ont le droit de réglementer la pêche sur leur territoire, de juger et de sanctionner les contrevenants. « La logique est de privilégier la polyvalence des pêches avec beaucoup d’engins mais peu intensifs. Leur puissance est donc limitée, pour permettre à chacun de vivre de sa pêche et de gérer la ressource », commente Élizabeth Tempier, secrétaire de la prud’homie de Sanary (83). Mais que pèsent ces initiatives face aux multinationales de la pêche industrielle ? D’autant que les fondations caritatives américaines soutiennent la privatisation des droits de pêche, car plus faciles à gérer. Grâce à leur puissance financière, elles ont déjà pris le contrôle du marché aux États-Unis, décidant ainsi de ce qui est vertueux et ce qui ne l’est pas. Si l’on n’y prend pas garde, elles pourraient bien faire de même en Europe.
Le point sur les ressources...
Enfin un coin de ciel bleu dans le catastrophisme ambiant ! Une étude prospective très récente publiée par la Banque mondiale en partenariat avec la FAO confirme que la production mondiale de produits halieutiques va continuer de croître pour atteindre 180 millions de tonnes par an à l’horizon 2030. Si les produits de la pêche ont atteint leur maximum dans les années 90 et ne progresseront plus en valeur globale, ils ne s’effondrent pas pour autant. Le complément étant apporté par l’aquaculture, dont le développement connaîtra une croissance linéaire. Les deux grands défis qui attendent la planète dans les prochaines années consistent donc, d’une part, à maîtriser les enjeux écologiques et sanitaires des productions aquacoles en pleine expansion ; d’autre part, à ¬accompagner les pêcheries existantes dans leur gestion de la ressource et à minimiser leur empreinte sur le milieu naturel. Les pêcheurs y ont tout intérêt : ce sont les premiers à subir les conséquences de la surpêche.
Évolution des stocks de poisson de 1984 à 2030
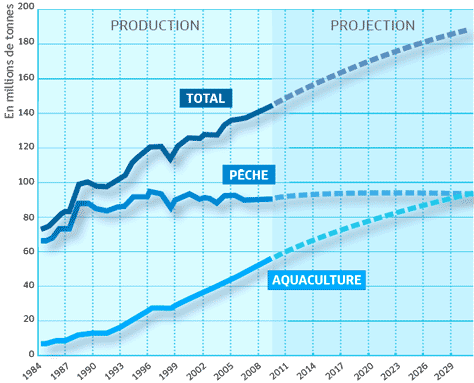
Aquaculture : un essor fulgurant...
Pour faire face à la demande toujours croissante en protéines de poisson, l’aquaculture a longtemps fait figure de solution miracle. Encore balbutiant dans les années 70, l’élevage de poissons de mer et d’eau douce, de crustacés et de coquillages, connaît, depuis une vingtaine d’années, une croissance exponentielle avec une progression moyenne de 6 % par an. Conséquence, aujourd’hui près d’un poisson sur deux consommé dans le monde est issu de la filière aquacole. Mais ce boom s’est accompagné des problèmes inhérents à l’élevage intensif : rejet massif de déjections et de déchets alimentaires dans les eaux environnantes, épandage de solutions médicamenteuses, épizooties, apparition de souches antibiorésistantes, etc. Résultat, la plupart des zones de production ont subi des atteintes graves à l’environnement. Pourtant, le développement de l’aquaculture semble irréversible. Encore faut-il qu’il respecte des critères sanitaires stricts, si l’on veut éviter que ne se reproduisent les scandales qui ont entaché la filière de l’élevage animal. De plus, pour préserver la biodiversité, l’empreinte écologique des élevages doit être maîtrisée. Ce qui est loin d’être toujours le cas. Ainsi, la demande des pays riches porte surtout sur des espèces carnivores, saumon, bar, daurade, etc., dont la nourriture est en partie composée de farines et d’huiles de poisson. Pour produire 1 kg de saumon, il faut 2,5 kg de poissons fourrage (anchois, sardines, maquereaux…). Durant ces dernières années, les producteurs se sont efforcés de remplacer les farines et les huiles de poissons, devenues rares et chères, par des végétaux (soja, maïs, lupin) dans l’ordinaire des salmonidés. Difficile, toutefois, de rendre ces carnivores totalement végétariens, surtout si l’on veut préserver leur intérêt nutritionnel pour les consommateurs, et notamment garantir leur teneur en oméga 3.
S’inspirer de la biodiversité...
À l’inverse, la filière extrême-orientale s’oriente vers des élevages intensifs d’espèces d’eau douce ou d’eau saumâtre comme la carpe, le panga ou le tilapia, qui est en passe de devenir le poisson le plus consommé dans le monde. Ces poissons omnivores ou végétariens mangent beaucoup moins de farines animales. Dans certains cas, ils peuvent être associés à l’élevage des crevettes avec lesquelles ils présentent des complémentarités favorables aux équilibres environnementaux. Même si ces espèces représentent pour l’heure plus de 80 % de l’élevage mondial, il reste à convaincre les consommateurs européens que les qualités gustatives de ces poissons sont équivalentes à celles des bars ou des daurades. Pas évident ! Pourtant, un poisson d’eau chaude comme le tilapia pourrait être élevé en circuit fermé sous nos latitudes. Les pays du Nord devraient aussi creuser dans leur biodiversité naturelle et développer l’élevage d’autres espèces comme le mulet ou la saupe. « Il faut reproduire les écosystèmes, en compartimentant les élevages et en élevant des espèces qui se développent bien ensemble, afin que l’une nettoie les déchets produits par l’autre », préconise Jean-François Baroiller, directeur adjoint du Cirad (Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement). Par exemple, les rejets d’azote et de phosphore d’un élevage de bars peuvent être aspirés par les holothuries (ou concombres de mer), un mets très apprécié dans toute l’Asie du Sud-Est. Un autre compartiment ¬permettra la production d’algues qui se nourrissent des éléments minéraux contenus dans les rejets. Enfin, un dernier compartiment abritera une espèce herbivore qui se nourrira de ces mêmes algues. Un modèle presque parfait, malheureusement encore loin d’être entré dans les pratiques des aquaculteurs.
Du côté des labels:
- Certains sont contestables...
Quoi de plus « bio » qu’un poisson à l’état sauvage qui se nourrit de plancton ou de petits poissons frétillants dans les eaux vives de l’océan ? Et pourtant, paradoxalement, il ne peut prétendre à l’estampille AB. La filière aquacole s’est battue bec et ongles contre les pêcheurs pour avoir l’exclusivité de la dénomination. Avec pour argument principal que la qualité sanitaire de l’alimentation du poisson sauvage n’est pas contrôlée et comporte des risques de pollution par des métaux lourds, des PCB ou des résidus de pesticides. C’est vrai, mais le risque existe aussi pour les poissons d’élevage, qui se nourrissent de granulés élaborés à base de poissons sauvages ! Bien sûr, la filière « bio » prétend lutter contre les dérives de la production intensive des poissons d’élevage. La densité dans les cages doit être plus faible, les traitements vétérinaires sont limités et la ponte des œufs ne peut être provoquée par l’utilisation d’hormones artificielles. Quant à l’alimentation des poissons, elle associe des ingrédients végétaux issus de l’agriculture biologique (et sans OGM) avec des huiles et farines de poisson. Mais quand on sait que le numéro 1 mondial du saumon, Marine Harvest, est aussi le premier producteur de poissons d’élevage « bio », on peut avoir quelques doutes sur le niveau de contraintes des cahiers des charges. Ces élevages se calquent sur le modèle industriel, même s’il existe, comme partout, des producteurs « bio » qui font du bon travail.
- D’autres vont dans le bon sens...
Quant aux écolabels destinés aux produits de la pêche, le plus répandu est l’anglo-¬saxon MSC (Marine Stewardship council). Il est attribué après une évaluation exhaustive de la pêcherie, par un organisme tiers en partenariat avec des ONG et des scientifiques, selon des critères très exigeants de durabilité des stocks et de l’environnement (mais pas de qualité !) En raison du coût élevé de la certification, MSC est surtout l’apanage des pêcheries industrielles. En France, cinq pêcheries seulement ont obtenu leur qualification : Euronor pour le lieu noir en mer du Nord, la sardine de bolinche en Bretagne du sud, la pêcherie d’églefin et de cabillaud d’Arctique Nord-Est, la pêcherie du lieu noir de la Scapêche (Intermarché) et de la compagnie des pêches de Saint-Malo, auxquelles s’ajoute la pêcherie de la légine dans les îles Kerguélen. Enfin, certaines organisations de pêcheurs ont fait le choix de la qualité : Filière Opale, Normandie Fraîcheur Mer, Bretagne Qualité mer. Elles imposent à leurs adhérents un cahier des charges très strict (trait de chalut limité dans le temps, cales identifiées pour éviter le mélange des espèces, entreposage en chambre froide sitôt la pêche débarquée, étiquetage assurant la traçabilité du poisson et la vente au premier acheteur en moins de 24 heures). D’autres labels privilégient le mode de capture, comme les ligneurs de la Pointe Bretagne. Enfin, la marque Pavillon France garantit une origine 100 % française.
Florence Humbert.
